Note de lecture
Jean-Jacques Gandini, Le procès Papon, Le passager clandestin
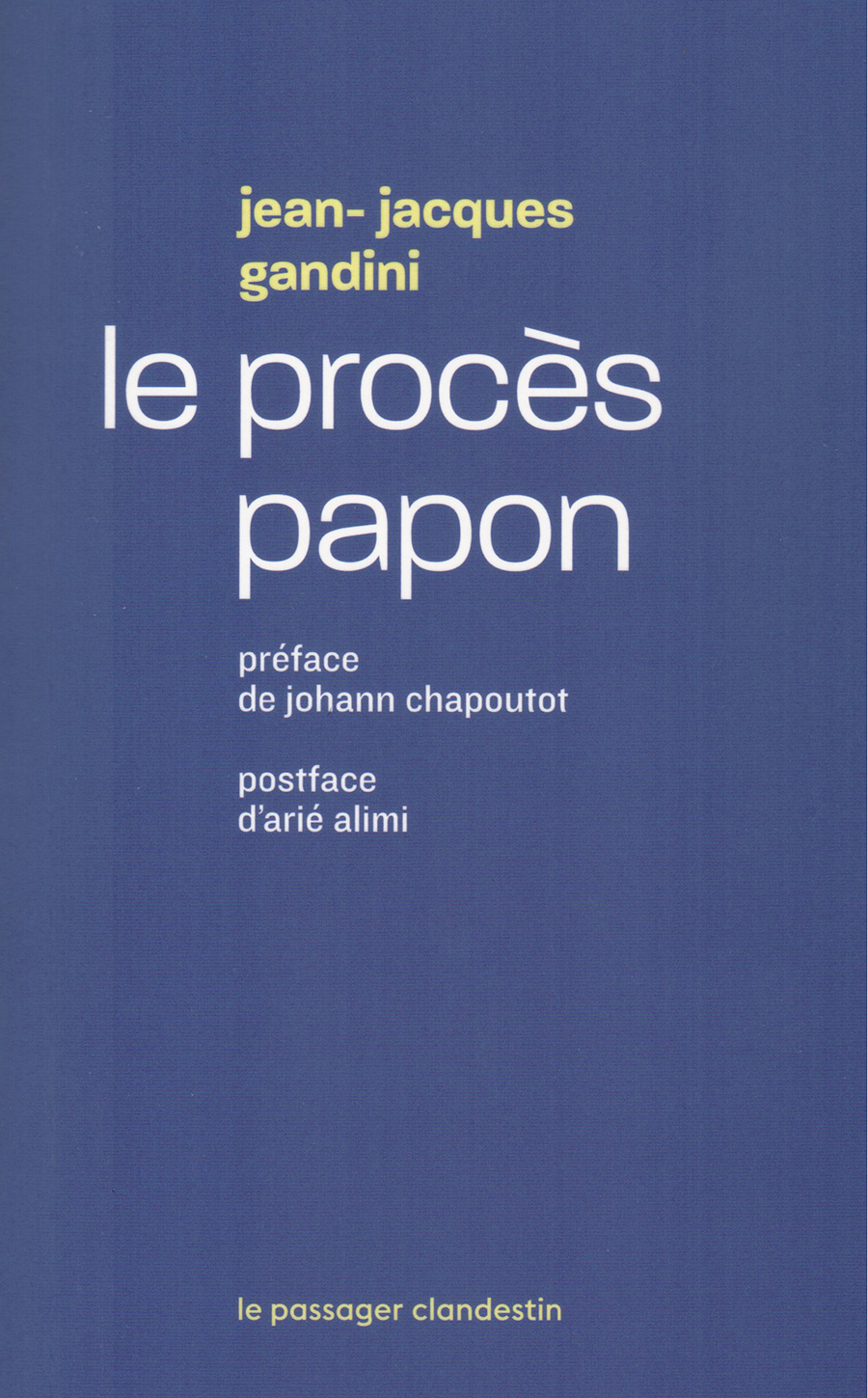
Jean-Jacques Gandini, Le procès Papon, préface de Johann Chapoutot, postface d’Arié Alimi, le passager clandestin, 2025, 240 p., 12 euros.
Le 8 octobre 1997 débutait le procès de Maurice Papon (1910-2007) devant la cour d’assises de Bordeaux, après des années de batailles juridiques. C’est en effet en 1981 que les premières plaintes avaient été déposées contre l’accusé pour « crimes contre l’humanité » à l’initiative de victimes ou de leurs descendants.
L’auteur du livre, avocat de profession et membre de la Ligue des droits de l’homme, assista en observateur à l’intégralité des audiences et en tira un petit livre, Le Procès Papon : histoire d’une ignominie ordinaire au service de l’État (Librio, 1999) qu’il reprend et complète pour cette nouvelle édition.
Informés et clairs, les différents chapitres du livre présentent l’ensemble de l’affaire à partir de la question initiale « Pourquoi Papon ? ». En effet, son procès venait après ceux, évidents, de Klaus Barbie, le tortionnaire nazi bourreau de Jean Moulin et des enfants d’Izieu, en 1987, puis celui du milicien psychopathe et antisémite Paul Touvier en 1994. Le profil de Maurice Papon est tout autre puisque celui-ci a accompli une longue carrière de haut fonctionnaire et d’homme politique sous l’égide des radicaux-socialistes de la IIIe république, puis de Vichy, des socialistes après 1945, du gaullisme après 1958, devenant député du Cher en 1968, rapporteur de la commission des finances à l’Assemblée nationale (1973-1978) et ministre du Budget du gouvernement de Raymond Barre en 1978. Comme l’écrit Gandini, il couronnait ainsi « cinquante ans de carrière politico-administrative ininterrompue sous quatre régimes différents et en “épousant” à chaque fois la couleur dominante du moment ». Ce « si brillant » parcours s’achève avec la publication le 6 mai 1981 dans Le Canard enchaîné d’un article en Une intitulé « Quand un ministre de Giscard faisait déporter des Juifs. Papon, aide de camp ».
L’ouvrage examine ensuite le contexte d’un régime de Vichy complice de l’extermination des Juifs ; l’objet de la poursuite qui vise Papon, à savoir sa responsabilité dans les rafles et les convois à destination d’Auschwitz via Drancy partis de la région bordelaise ; le double jeu de Papon par rapport à la Résistance quand la défaite allemande semble assurée. Celui-ci lui réussit au nom de la continuité de l’État : « Le 23 août 1944, sans avoir cessé jusque-là d’exercer ses fonctions de secrétaire général de la préfecture vichyste, Maurice Papon est nommé par le nouveau commissaire de la République, Gaston Cusin, préfet des Landes et directeur de son cabinet. » Au bout de six mois de procès, le verdict tombe : Papon est coupable de complicité de crime contre l’humanité, mais demeure en liberté du fait du caractère suspensif du pourvoi en cassation déposé par ses avocats qui, après son rejet, saisiront la Cour européenne des droits de l’homme. Le décès de Maurice Papon le 8 février 2007 met fin à des décennies de procédure judiciaire.
Jean-Jacques Gandini évoque encore dans un dernier chapitre additionnel la responsabilité de Papon, alors préfet de police de Paris, dans la répression de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961 où celui-ci n’est pas le seul en cause mais apparaît « en première ligne ». Gandini juge à juste titre que la reconnaissance du 17 octobre 1961 comme crime d’État est encore « inachevée » ; elle n’en a pas moins été en partie reconnue, y compris au plus haut niveau, grâce, en particulier, au travail de quelques historiens et archivistes qui ont réussi à alerter l’opinion publique. Par rapport à d’autres pays confrontés à des pages sombres de leur histoire, la société française n’est pas la pire si l’on songe au traitement du passé franquiste de l’Espagne jusqu’à nos jours dans ce pays, sans parler du négationnisme d’État dans la Russie de Poutine où celui-ci joue les historiens en chef, interdisant l’ONG Mémorial en même temps qu’il lançait sa deuxième guerre d’agression contre l’Ukraine[1].
Charles Jacquier
[1] Nicolas Werth, Poutine historien en chef, Tracts/Gallimard, 2022.
Le Journal des Poètes, numéro 3, 2025
Le Journal de poètes #3 2025 évoque la mémoire de Léon-Gabriel Gros, dont l’un des poèmes majeurs, Phœnix, a fourni son titre à notre revue. Le dernier livre d’Isabelle alentour, Chaque jour je lie, je relie, y est également recensé.
Tahar Djaout : Les vigiles, éditions du Seuil
Même si la France, voici dix ans, a subi de plein fouet le terrorisme islamique, nous n’avons ici qu’une vague idée de la chape de terreur qui s’abattit sur l’Algérie au tournant des années 90….
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, éditions AEncrage & Co
Il y a des livres et des auteurs – des autrices – qui n’existent dans une langue que grâce à la conviction d’un traducteur qui décide d’endosser avec ténacité un ouvrage – une œuvre – pour le porter à la connaissance d’un public posté sur l’autre rive…
Anne Mulpas, Macadam donna (ça me trouble), éditions de Corlevour
Au magnifique catalogue des poètes parus aux éditions de Corlevour, Anne Mulpas vient ajouter une voix très sûre et singulière qui prend ici racine en Terre, Terra, Gaïa ou tapis des vaches, en toutes sortes de décors plantés pour faire entendre en un recueil polyphonique les « trois protagonistes du vivier »
Laurence Verrey, De la soif, Bernard Campiche éditeur
L’expérience de la traversée est la seule expérience » écrivait Christian Gabriel/le Guez Ricord dans Rosace. Comment ne pas éprouver ici, dans ces pages de Laurence Verrey, le témoignage d’une telle pratique ?
John Reed, Broadway la nuit et autres écrits, Nada
Le livre de John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde, a connu depuis sa première publication en 1919 à New York de nombreuses traductions et d’innombrables rééditions, devenant un best-seller international depuis plus d’un siècle. Actuellement, en France, il en existe deux éditions de poche et plusieurs brochées, la meilleure et la plus complète étant sans doute celle des éditions Nada…
Howard Fast, La route de la liberté, Les bons caractères
Auteur fécond et divers, le romancier et scénariste états-unien Howard Fast (1914-2003), d’origine juive ukrainienne, est l’auteur d’une cinquantaine de romans et de plusieurs recueils de nouvelles. Adhérent du Parti communiste américain, il figure aussi parmi les victimes de la commission McCarthy.
Mélusine Reloaded, Laure Gauthier, éditions José Corti
Jour chômé_un temps pour soi. Derrière la porte close, choisir un livre, se laisser appeler. MÉLUSINE RELOADED > une fée pour recharger les batteries, trouver des munitions, celles du vivre et du créer. Un conte écoféministe, un roman dystopique… oui sans doute… mais avant tout un geste.
Benjamin Schlevin, Les Juifs de Belleville, L’échappée
Depuis 2023, la collection « Paris perdu » s’attache à un monde pourtant pas si lointain, mais bel et bien disparu tout en affirmant : « Si le vieux Paris n’est plus, sa nostalgie, plus belle encore, demeure »…
Mathieu Nuss, Accro et mélomaniaque, éditions Esdée
Poète, musicien, revuiste, lecteur critique, entre autres, Mathieu Nuss livre ici un singulier ouvrage aux (toutes neuves) éditions Esdée qui promeuvent la rencontre des artistes et des livres…
Jean-Claude Pinson, Vies de philosophes, éditions Champ Vallon, par Etienne Faure
Beaucoup de philosophes naguère étaient poètes. L’étroite imbrication de la poésie et de la philosophie est certes ancienne mais varie selon les époques dans un échange où la philosophie pense la poésie et où le poème pressent la philosophie et la révèle…
Jacques Vincent, Mémographies, éditions Henry, par Etienne Faure
En saisissant le petit volume de Jacques Vincent « Mémographies (Roman) » on trouve un recueil à sa main, en effet, comme un bel outil compact et adapté pour dire beaucoup en peu d’espace. Et voilà qu’on découvre un livre dense et concis annoncé également comme « roman »…
Gérard Macé, Silhouette parlante, éditions Gallimard, par Etienne Faure
Pour celles et ceux qui ont la chance de lire régulièrement Gérard Macé, c’est toujours le sourire aux lèvres qu’ils abordent un de ses nouveaux ouvrages. Car cette voix très distincte, distinguée, feutrée – et même féroce– nous a habitué à lire avec cette légère distance focale entre les lignes de la vie qu’il donne à voir sous forme d’essais, de notes, de déambulations, de colportages…
Guillaume Métayer, Mains positives, éditions la rumeur libre, par Etienne Faure
On connaît Guillaume Métayer pour son activité de traducteur qu’il mène de longue date avec passion et persévérance, en de nombreuses langues, de nombreuse voix centre-européennes, certes différentes et cependant étroitement voisines, géographiquement s’entend…
Christophe Mahy, Au bout du compte, suivi de L’âme au large, Gallimard, par Étienne Faure
C’est en deux titres que le nouveau recueil de Christophe Mahy se présente : Au bout du compte, suivi de L’âme au large. Des titres qui s’apparenteraient de prime abord à un bilan et à un éloignement en périphérie de la vie, vers ses embouts : l’enfance et la mort…
Filippo De Pisis, Mais un peu de ta grâce, traduction Franck Merger, Alidades Bilingues, par Karim De Broucker
Depuis les rives du lac d’Annecy, où est sise la maison d’édition Alidades, un bien joli papillon s’est venu poser sur le bord de nos mains : un choix de poèmes de Filippo de Pisis (1896-1956), d’ordinaire mieux connu comme peintre.
Pierrick de Chermont, M. Quelle, Poèmes en prose avec cinq aquarelles de Marianne K. Leroux, L’atelier du grand Tétras, par Karim De Broucker
Dans ce nouveau livre de poésie, Pierrick de Chermont a le toupet malicieux d’user du terme définir pour présenter son personnage éponyme comme étant « le portrait de celui ou celle qui n’en ont pas », ou bien comme « jardinier, électricien ou homme d’affaires »…
Patrick Chastenet, Introduction à Bernard Charbonneau, La Découverte, par Charles Jacquier
Déjà auteur en 2019 d’une Introduction à Jacques Ellul dans la même collection, Patrick Chastenet livre ici un utile et roboratif petit livre d’initiation aux idées de son compère personnaliste et écologiste gascon, longtemps oublié et méconnu…
Joë Bousquet, Au seuil de l’indicible, éditions Arfuyen, textes rassemblés et présentés par Claude Le Manchec
Il y a tout juste un an paraissait dans le numéro de Novembre-Décembre de la revue Europe un « dossier Joë Bousquet » (1987-1950), présenté par Jean-Gabriel Cosculluela…
Christine Guinard, Ils passent et nous pensent, éditions unicité, par Nicolas Rouzet
Ceux qui passent et nous pensent ce sont ces 450 000 républicains, réfugiés de la guerre civile espagnole, qui traversent à pied les Pyrénées à partir de février 1939, pour arriver en France où ils sont ( mal ) accueillis…
Marilyne BERTONCINI et Wanda MIHULEAC, Sable (Sand), Ed Transignum, par Murielle COMPÈRE-DEMARCY
Ici, le livre de Sable s’écoule comme le temps file entre nos doigts au rythme de la figure maternelle dont la perte ouvre une brèche, franchissable, mais inguérissable, et dont le souvenir avant l’irruption de sa survenue demeure infrangible…
Gaëlle Fonlupt, A la chaux de nos silences, ed. Corlevour, par Anne Mulpas
D’un titre – à l’oeil, ce qu’il cherche à entendre de lui-même et du monde. D’un titre, son pouvoir d’accroche, d’évocation. Ciel-qui-lit, ESPRIT ET CIE flashent quelques images en excès de vitesse…
Panaït Istrati, Présentation des Haïdoucs, L’échappée, par Charles Jacquier
Présentation des Haïdoucs est le troisième volume de la tétralogie de l’écrivain roumain d’expression française Panaït Istrati (1884-1935) Les Récits d’Adrien Zograffi, mais chacun d’entre eux peut être lu séparément et celui-ci ne fait pas exception à la règle…
Justin Delareux, Écrase-mémoire, Pariah, par François Bordes
« Poète n’est pas doué pour habiter le monde, c’est le monde qui l’habite, et fait de lui un éternel passeur d’errances. » Justin Delareux est de ceux-là…
Serge Airoldi, Micmac Mécanic, ed. de l’Attente, par Anne Mulpas
Avant, juste au seuil du Tout premier jour — Jarry & Pasolini. Carpe, écrevisse, tanche… ciel-qui-lit se fait serrer direct par un « lacet magique ». Micmac Mécanic. Quezako ?…
L’Atelier Contemporain, 10 ans, 200 livres, une Maison, par Bernadette Engel-Roux
Aujourd’hui que nous ne recevons (presque) plus de catalogues d’éditeurs (certains se rappellent peut-être ces petits cartons insérés dans chaque ouvrage et qu’il suffisait de remplir et renvoyer pour « être tenu informé de nos publications »…
François Bordes, Zone perdue, par Anne Mulpas
Zone perdue – fragments d’itinérance. Je reprends ma chronique. Sa première version date déjà d’il y a trois semaines. A L’ours & la vieille grille. Sa deuxième version s’impose après mon cheminement dans l’exposition Rothko. Me voici au troisième temps du texte, à moins que ce ne soit le quatrième, le centième…
Alicia Dujovne Ortiz, La Maréchale rousse, par Charles Jacquier
Journaliste, biographe, critique littéraire et romancière, Alicia Dujovne Ortiz, née en 1940 à Buenos Aires, s’est exilée en France en 1978 au moment de la dictature militaire et y vit encore aujourd’hui…
Jean-Patrick Manchette, Derrière les lignes ennemies (Entretiens 1973-1993), par Charles Jacquier
Le lecteur se demandera peut-être pourquoi ce recueil de vingt-huit entretiens avec l’auteur de polars Jean-Patrick Manchette (1942-1995) porte ce titre martial, plus adapté à un traité de stratégie….
Colette Klein, Après la fin du monde, par Sylvestre Clancier
Ce livre préfacé par Antoine Spire, président du PEN Club français, est à la fois beau et fort. Il est même poignant par l’expression poétique de son auteure qui mieux que d’autres sait dire la tragédie de l’humain…
Max Alhau, En d’autres lieux, par Sylvestre Clancier
En d’autres lieux, le nouveau livre /poème de Max Alhau, transporte dans un ailleurs familier celles et ceux qui lisent et apprécient l’œuvre poétique de ce poète contemporain majeur…
Élisée Reclus, Histoire d’une montagne Histoire d’un ruisseau, par Charles Jacquier
En 1869, huit ans après la publication de son premier livre – en dehors des guides de voyage auxquels il a déjà collaboré, Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe –, le géographe Élisée Reclus (1830-1905) publie Histoire d’un ruisseau.
Cécile A. Holdban, Osselets, par Anne Gourio
Poursuivant dans Osselets sa veille attentive du sensible, Cécile A. Holdban offre dans son dernier recueil un ensemble de très brefs poèmes associés en séries…
Matthieu Gimenez, L’étendue de la lumière, par Nicolas Rouzet
L’étendue de la lumière, c’est celle que parcourt le jour, entre l’aube, midi et la nuit, les trois temps qui ponctuent ce recueil. Il y a quelque chose du veilleur chez Matthieu Gimenez.
Julie Nakache, Le sang des filles, par Nicolas Rouzet
L’auteur s’empare du thème de la filiation, celle d’une lignée de femmes : reines-mères-guerrières-sorcières…
Dominique Sorrente, Ici ne tient jamais en place, par Nicolas Rouzet
Pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que Dominique Sorrente est un méditerranéen…
Gérard Bocholier, Vers le visage, Éditions Le silence qui roule, par Hervé Martin
Gérard Bocholier est l’auteur d’une quarantaine de livres de poésie. Il dirige la revue ARPA et est responsable de la rubrique poésie de l’hebdomadaire La Vie.
Florence Delay, Zigzag, par Serge Airoldi
Tout livre de Florence Delay arrive toujours avec son remarquable cortège de vivacité malicieuse, d’ardeur intacte, d’intelligence sans cesse renouvelée
François Migeot, Au fil de la chute, par Pierrick de Chermont
L’écrivain, que peut aussi être le poète, ne se recoupe pas forcément. Par exemple, entre l’essayiste de l’Art Romantique et le poète des Fleurs du mal
Jean Luc Marion, La métaphysique et après, par Pierrick de Chermont
Cet ouvrage, comme souvent chez l’académicien phénoménologue, est un récit fleuve portant sur l’enquête historique d’un concept : celui de la métaphysique
Robert Desnos, Poèmes de Minuit – par Jean-Paul Rogues
On ne peut s’empêcher de penser au dîner où un officier allemand déclare « il paraît que l’on vient d’arrêter vos deux plus grands poétes »
Frédéric Boyer, Évangiles, Gallimard – par Pierrick de Chermont
« Nous vivons en présence d’un Érasme de notre temps et nous ne le savions pas ». Voilà ce que nous nous disions lors d’une soirée suivant un récital de poésie…
Jean-Paul Bota, Lieux, éditions Tarabuste – par Étienne Faure
Voici avec Lieux le dernier recueil de Jean-Paul Bota. Un titre qui ressemble décidément à l’auteur et à toute son œuvre
Sabine Huynh, Elvis à la radio, Maurice Nadeau – par Pierrick de Chermont
Finissant ce récit, je m’écriai pour moi-même : « Que de souvenirs pour une sans-mémoire !
Pierre Bergounioux, La Gorge, Fata Morgana – par Jean-Paul Rogues
Avec La Gorge, Pierre Bergounioux entre dans le cercle de ceux, les rares qui, par leur prose, nous font franchir un seuil…
Ariel Spiegler, Le Mélange de l’eau, Corlevour – par Anne Mulpas
Soir de février — 33e jour d’hiver sans pluie, souffle Iannis devant la Nouvelle Étoile
Au lendemain matin, François notre café-retrouvailles un poème…
Luis Mizon, par Sylvestre Clancier
Notre ami, le poète Luis Mizon, membre de l’Académie Mallarmé, nous a quittés à l’âge de 80 ans, le 30 décembre dernier.
Stéphane Barsacq, Solstices, Corlevour – par Pierrick de Chermont
Faut-il s’intéresser à nouveau à la Morale, entendue comme un pan de la littérature où une voix exprime sa vie intérieure sous forme de monologue, d’interrogations, de quête, de résolutions ; parlant de sa vitalité et de sa misère…
François Sureau, Un an dans la forêt, Gallimard – par Pierrick de Chermont
Blaise Cendrars. Un nom, un un-ivers, et pourtant il dégage une telle prolixité qu’il décourage toute tentative d’approche. En effet, quoi de commun entre la Prose du Transsibérien, Poèmes élastiques, Moravagine, Pâques à New York, L’Or, La main coupé, Petits contes nègres, etc. ?
Ervé, Écritures carnassières, Maurice Nadeau, coll. à vif – par Pierrick de Chermont
S’il est un livre à lire en 2023, c’est bien celui d’Ervé, un récit-témoignage construit par fragments, un texte à hauteur d’homme. Une vie de dignité depuis la DDASS jusqu’aux trottoirs, avec ses défonces, ses couches de vêtements…
Séverine, L’insurgée, L’échappée – par Charles Jacquier
Sympathisante libertaire et proche de Jules Vallès, Sévérine (Caroline Rémy, dite – 1855-1929) fut l’une des premières femmes journalistes. Au cours de sa vie, elle écrira plus de 6 000 articles…
Jack London, La peste écarlate, Libertalia – par Charles Jacquier
Publié en 1912, ce court roman d’anticipation méconnu de Jack London (1876-1916) imagine le sort de l’humanité, ou de ce qu’il en reste, quelques dizaines d’années après qu’elle a été frappée par un virus meurtrier.
Guy Debord, Histoire, L’échappée – par Charles Jacquier
Après les volumes Stratégie, Poésie etc., Marx Hegel (voir Phoenix, n° 32 & 36), ce nouveau volume des fiches de lecture de Guy Debord, conservées à la Bibliothèque nationale de France, est consacré à l’histoire.
Étienne Faure, Vol en V, éditions Gallimard – par Anne Gourio
Comme on suit, fasciné, la trajectoire des oiseaux migrateurs, le dernier recueil d’Etienne Faure puise dans le ballet aérien de leur « vol en V » un sens de l’élan, du franchissement, du frayage qui se nuance en légères et souples inflexions au fil des espaces traversés à tire-d’aile…
Justyna Bargielska, L’enfant des dons, éditions LansKine – par Étienne Faure
C’est en version bilingue, grand luxe en ces temps, que le sixième recueil de la poète polonaise, Justyna Bargielska, est présenté par Isabelle Macor, traductrice, qui donne quelques repères décisifs en postface pour une entrée en matière dans ces trente-trois textes…
Frédérique Guétat-Liviani, Il ne faudra plus attendre un train, éditions LansKine – par Étienne Faure
Ce recueil emprunte son titre à l’une des trois parties qui le composent : si c’était le cas, (passe) ; il ne faudra plus attendre un train. En découvrant cette composition, on pense spontanément à un ensemble où viendrait s’intercaler le texte de (passe). Puis l’œil et l’oreille distinguent vite une même voix, dans ces deux pans, deux partis pris formels différents dans le cheminement de l’écriture de Frédérique Guétat-Liviani.
Eric Villeneuve, Tache jaune Monochrome bleu Sorte de blanc, éditions LansKine – par Étienne Faure
Eric Villeneuve est-il un grand enfant, nourri aux contes et au Danemark d’Andersen, entre Odense et Skagen ? Cet auteur qu’on a pris l’habitude de lire sous la rubrique « roman », livre ici un recueil un rien hybride qui prend son départ dans la force des mots, leur indépendance, dont, à la source, ceux de « Jensens, Brohus Odense ».
Thierry Romagné, Trois feux de langue, éditions Rehauts – par Étienne Faure
Un recueil qui commencerait par « Ahh, ahh, brr ! » et se clôturerait par « enfin en feu » serait bien prometteur. Un texte polyglotte prêt à tout. C’est en effet ce qui arrive au lecteur en découvrant cet étonnant et riche ensemble dont certains poèmes, pour notre bonheur, avaient d’abord paru dans plusieurs revues.
Le journal des poètes 1/2022 – par Nicolas Rouzet
Le Journal des Poètes, numéro 1 de l’année 2022 – La langue est aussi frontière, nous dit Jean-Marie Corbusier, pratiquer un art, c’est toujours ouvrir quelque chose qui est présent autour de nous. C’est d’un même esprit d’ouverture que témoignent les poètes luxembourgeois auxquels est consacré le dossier présenté par Florent Toniello. Ici les langues dépassent les frontières, elles se chevauchent…
